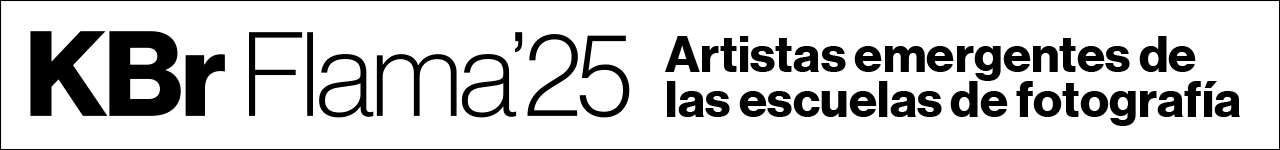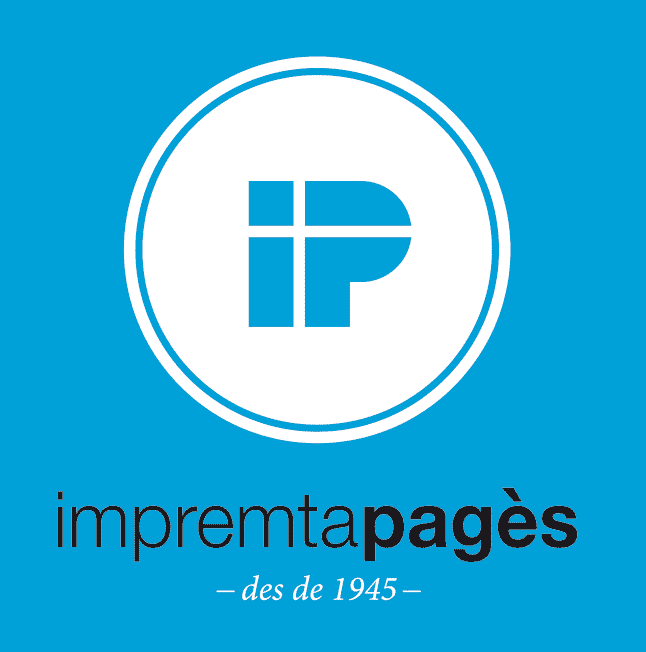Avis
SOS art et bureaucratie

La bureaucratie, disait Hannah Arendt, est l’un des outils démocratiques par excellence. Dans les appels à propositions, les candidatures, les appels d’offres, les interventions, nous devons toujours nous rappeler, aussi absurdes soient-ils, qu’ils sont conçus pour que chacun ait accès aux ressources avec les mêmes droits, sans distinction de classe, de sexe ou de race. Cependant, une bureaucratie mal comprise, utilisée de manière systématique et uniforme, et qui ne prend pas en compte les particularités et les fragilités de chaque secteur où elle est mise en œuvre, peut devenir un problème démocratique, un limiteur des droits fondamentaux. Et la culture et les arts, tant qu’une vague d’extrême droite ne les emporte pas, sont toujours là.
Français Ces dernières années, les professionnels indépendants des arts du pays (artistes, commissaires d'exposition, directeurs artistiques, critiques, galeristes) ont subi les effets d'une nouvelle vague de réformes bureaucratiques qui découlent en grande partie de l'interprétation de la loi sur les contrats de 2017. Dans de nombreuses municipalités, on demande désormais au commissaire d'exposition ou à l'artiste, pour de petites sommes, de faire l'impensable : fournir des budgets préalables avec des chiffres convenus ; fourniture de contenu non rémunéré ; justification des données personnelles ; s'inscrire sur des portails obsolètes ; dans certains cas extrêmes récents, la même bureaucratie requise rend impossible l’exécution temporelle et matérielle de la même œuvre artistique demandée, entrant dans une dérive kafkaïenne indicible.
Dans les cas les plus complexes, les choses dégénèrent jusqu'à des limites insoupçonnées : dans les appels d'offres pour les contrats de direction artistique (nous l'avons vu lors du dernier à La Capella), on demande au candidat de fournir une assurance personnelle pour garantir la solvabilité économique, comme si nous étions de grands entrepreneurs ou des actionnaires. Des contrats de gestion limités à 2 ans sont proposés (cas Fabra i Coats examiné par le PAV). Justification certifiée de tout ce qui est annoncé. Et ainsi de suite, ce qui désespère les professionnels et techniciens de la culture, avec un nouveau phénomène aggravant : cela décourage les professionnels de postuler ; les productions sont reportées ; La libre expression artistique et culturelle des artistes, réalisateurs et commissaires d’exposition est appauvrie et limitée.
Tous les avocats consultés réaffirment qu'aucune loi n'exige cette frénésie d'obstacles et d'exigences bureaucratiques, mais que dans la plupart des cas, il s'agit d'interprétations de la loi 09/2017, avec des instructions venant « d'en haut » des administrations ; d'un « en haut » qui est tellement « en haut » qu'il est complètement inaccessible, que tout le monde craint et avec lequel on ne peut pas dialoguer pour trouver une entente et promouvoir une attitude empathique et compréhensive face à la fragilité structurelle de notre secteur. Des décisions qui proviennent, nous dit-on, d’interventions qui se nichent dans les hautes sphères des entités publiques, et qui dictent des instructions et des protocoles auxquels nous devons tous adhérer, afin d’avoir la tranquillité d’esprit que l’ensemble du système fonctionne de manière impeccable et contrôlable.
La philosophe et actuelle directrice de Bòlit Íngrid Guardiola, dans son essai La servitude des protocoles, parle de ce phénomène comme d'une « fétichisation biaisée de la loi », motivée par des prémisses qui cherchent à obtenir des archives immaculées et contrôlables, comme s'il s'agissait d'un dogme religieux incontestable. Tout doit être planifié, supervisé, démontré, radiographié, vérifié et contrasté. Mais cette rigidité « techno-bureaucratique » est en contradiction absolue avec la nature des arts : qui fonctionnent à partir de l’incertitude, du doute, de l’expérimentation, du changement, de la liberté de création. La loi doit pouvoir s’adapter à cette nature pour la rendre possible, comme le précise la Constitution, qui considère « la promotion et la protection de la culture » comme un droit fondamental. Comment un artiste peut-il prévoir deux ans à l’avance quelle pièce il va réaliser, avec quels matériaux, avec quels fournisseurs, avec quelles vis et de quelle marque ? Comment un commissaire d’exposition peut-il présupposer à quoi ressemblera toute une production artistique sur le point d’être réalisée ? Comment un directeur artistique peut-il se consacrer à la programmation de contenu s’il doit passer la plupart de son temps à anticiper et documenter son travail et à gérer les mille et un arrangements technologiques qui se présentent à lui ?
Ce qui aurait dû être une étape fructueuse et épanouissante dans la carrière professionnelle d'Íngrid Guardiola devient, comme elle le reconnaît, une torture personnelle lorsqu'il s'agit de se conformer à la loi pour embaucher et rémunérer professionnellement les artistes, les conservateurs et les agents du secteur. Résultat : l'un des meilleurs dirigeants que le pays ait connu ces dernières années ne sollicite pas à nouveau le nouvel appel qui lui a été adressé récemment après la fin de sa relation contractuelle.
Nous, professionnels indépendants des arts, exigeons des administrations des mesures sensées et urgentes afin de travailler activement à la résolution des réglementations bureaucratiques qui ralentissent déjà l’articulation de la création artistique dans notre pays. La classe politique doit sensibiliser et influencer les interventions pour adapter le droit des contrats aux travailleurs culturels, qui s’appuie sur une réalité économique déplorable. Parce que la culture et les arts sont un droit du citoyen, et les administrations ont le devoir de le faire respecter.